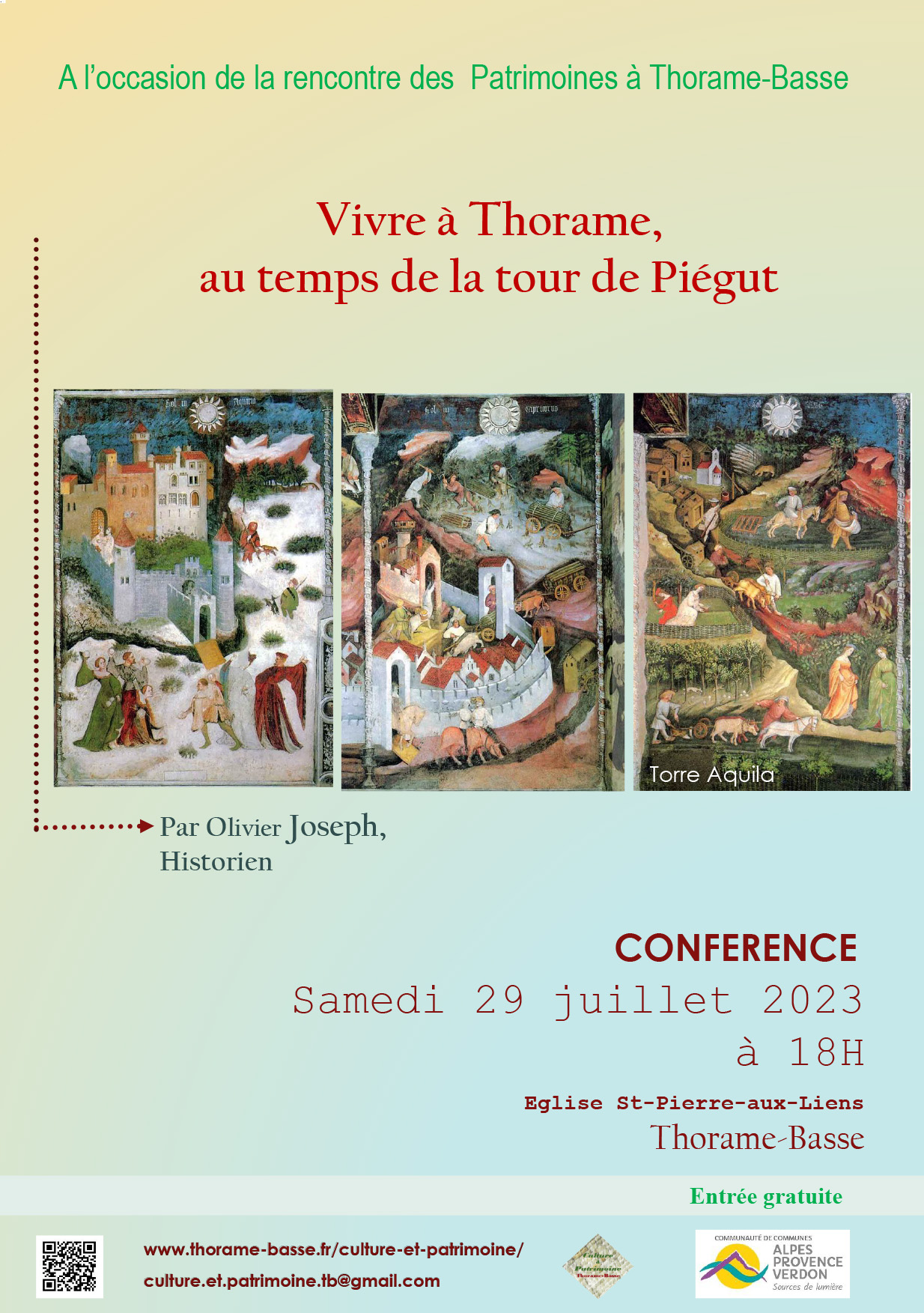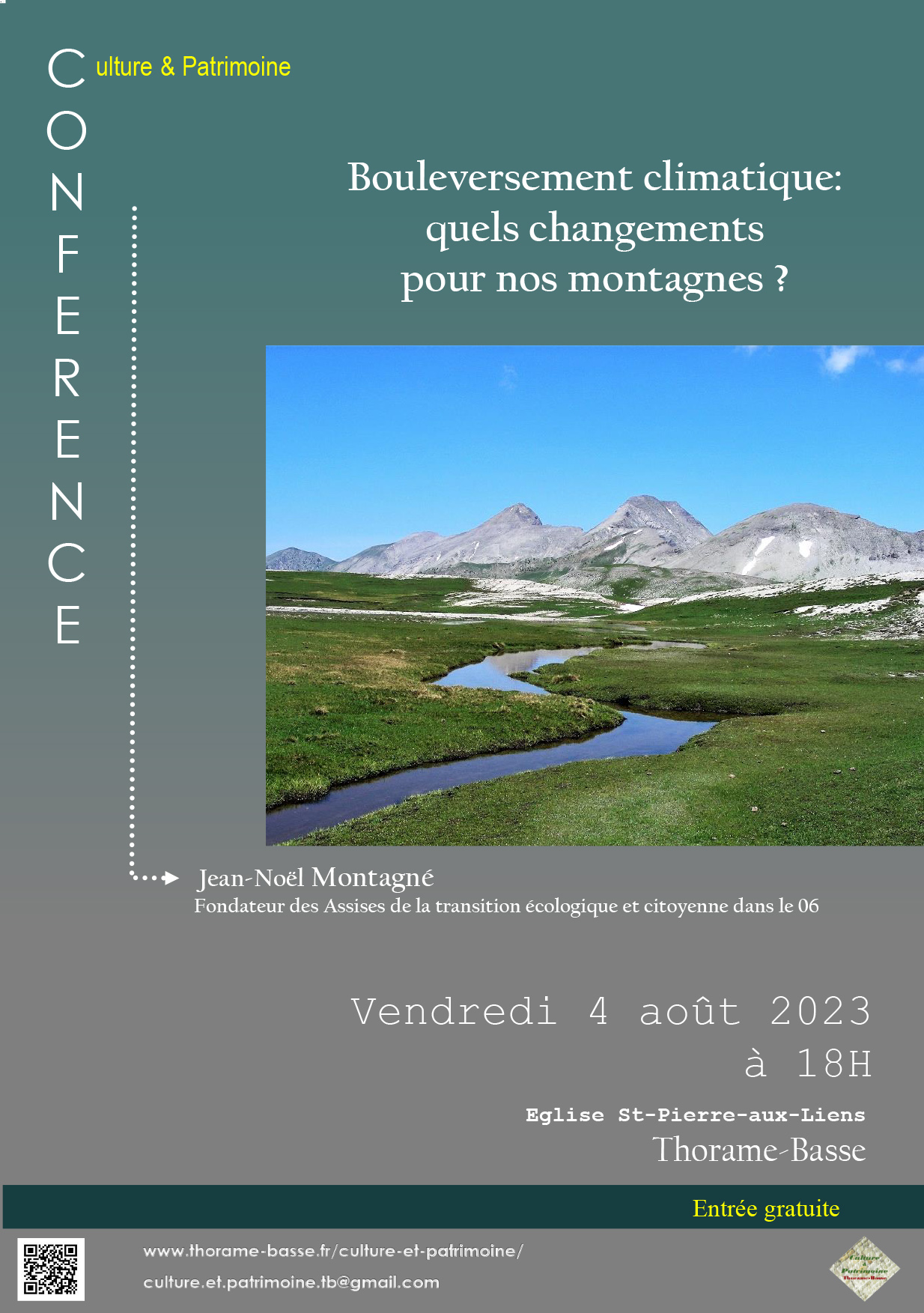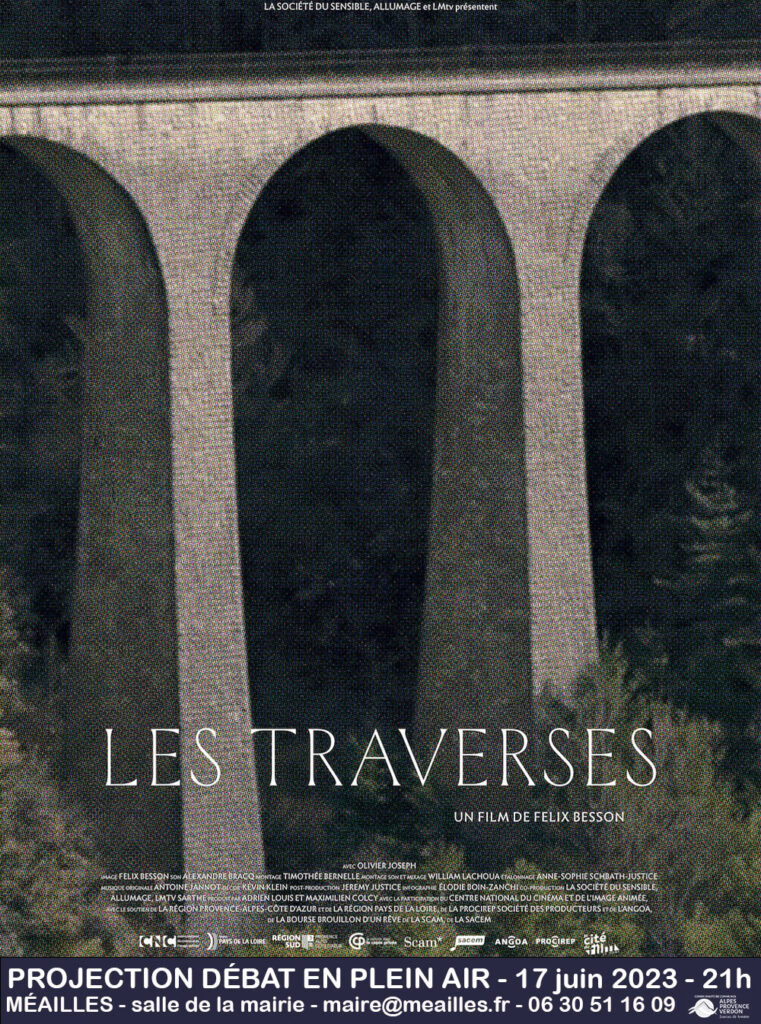Le samedi 29 juillet a rassemblé à l’occasion de la journée des Rencontres des Patrimoines organisée par la CCAPV, un public nombreux, varié et motivé.
329 personnes ont participé aux activités proposées, réparties tout au long de la journée.
– 50 personnes sont montées à la Tour de Piégut, accompagné par un accompagnateur de l’ONF, où Vincent Buccio, chef du service départemental d’archéologie a présenté sa longue histoire avec ses interrogations et son projet de restauration.


- À 12h30, 104 personnes ont partagé le repas organisé par l’association C&P, dans la convivialité.
Jean-Yves Miguel a offert son temps et son talent pour nous régaler de sa paëlla, Julie et Michel Margaillan, leur excellent fromage et le café de la Vallée a préparé « Le dessert de Piégut » à prix coûtant pour le plaisir de tous.


Les bénéfices récoltés de 1240 € vont être reversés à la Fondation du Patrimoine pour le projet de la tour.
– À 14h30, 25 personnes ont visité la chapelle St Thomas, accueillies par Mme Hodge, conseillère municipale qui a présenté les peintures murales.
– À 16h, 60 personnes ont déambulé dans les rues et sentiers du village, à la découverte de son histoire grâce à Laetitia Frasseto, guide conférencière.
– À 18h, 90 personnes ont écouté la conférence « Vivre à Thorame au temps de la Tour de Piégut », donnée par Olivier Joseph, historien, suivi d’un temps d’échange.


Au cours de cette journée, l’association C&P a pu mesurer :
– La qualité de collaboration avec les forces vives de la commune et avec nos divers partenaires pour la promotion du patrimoine.
– Le vif intérêt des Thoramiens et des habitants de la vallée au patrimoine local.
Les membres du conseil d’administration remercient chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué par leur présence, leur générosité et leur engagement à la réussite de cette journée.
Annonce initiale …
à l’initiative de la CCAPV, en partenariat avec la Municipalité, le Comité des Fêtes et C&P.
Chacun pourra participer aux rencontres proposées, librement.
Pour le repas, il est nécessaire de s’inscrire.
(Les bénéfices récoltés seront reversés à Fondation du Patrimoine,
pour soutenir le projet de consolidation et mise en valeur de la Tour de Piégut.)
| 10h-12h30 | Montée à la Tour de Piégut : Lecture de paysage par avec un accompagnateur en montagne et historique de la tour avec Vincent Buccio, Chef du service départemental d’archéologie du 04 RDV devant la Mairie – prévoir chaussures adaptées. Gratuit. |
| 12h30 à 14h30 | Repas (Paëlla, fromage, dessert), 25 €. Réservation avant le 22 juillet, à l’office du tourisme de Colmars-Les-Alpes colmars@verdontourisme.com – www.verdontourisme.com ou au 04 92 83 41 92 Apporter assiette, verre et couverts. |
| 14h30 à 15h30 | Visite de la chapelle Saint-Thomas, par Nicole Hogge. RDV à la chapelle. Gratuit. |
| 16h à 17h30 | Visite du village avec Laetitia Frassetto, guide-conférencière. RDV devant la Mairie. Gratuit. |
| 18h à 19h30 | Conférence « Vivre à Thorame, au temps de la Tour de Piégut », par Olivier Joseph, historien. RDV à l’église Saint-Pierre-aux-Liens. Gratuit. |