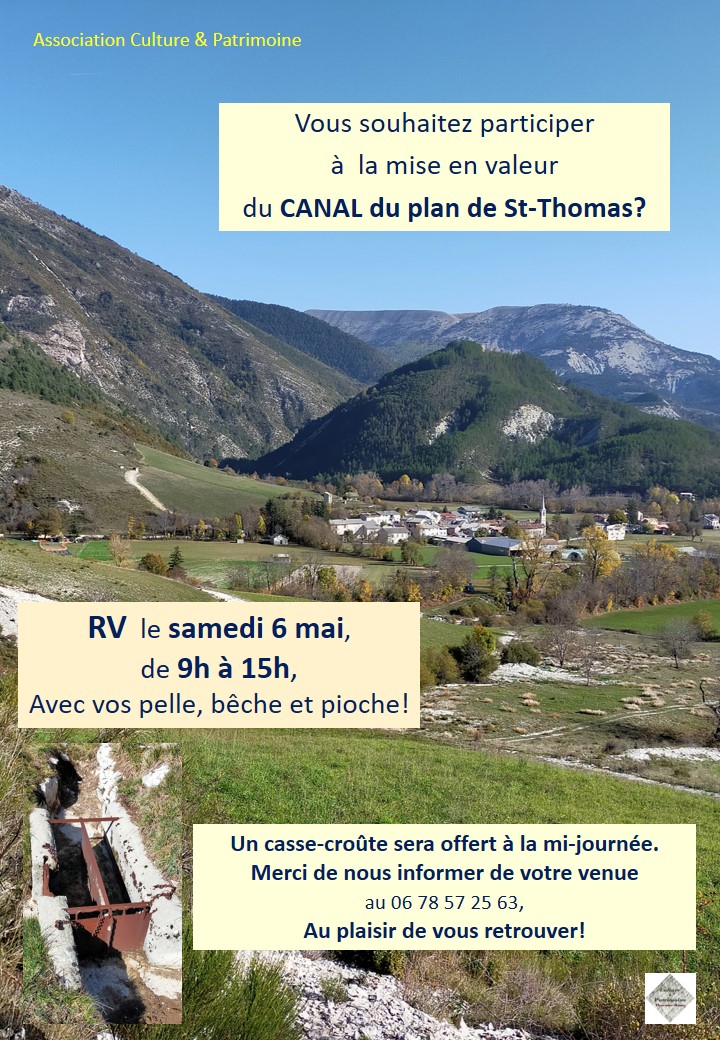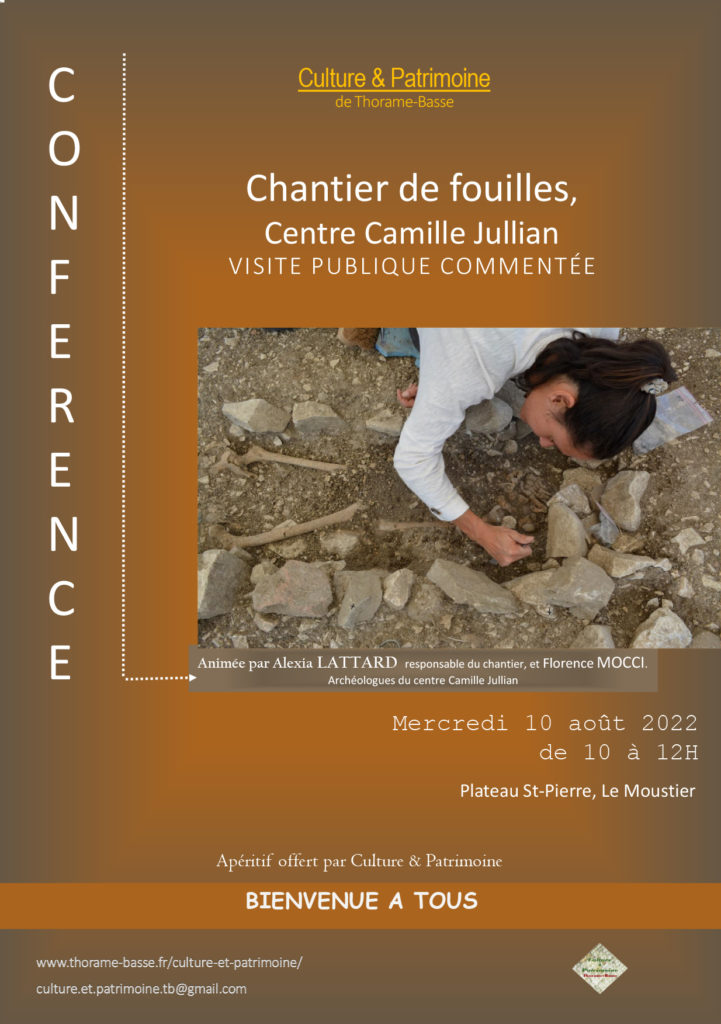Prospection-inventaire archéologique pédestre Thorame-Basse et Thorame-Haute (04)
(Extrait de F. Mocci, D. Isoardi, Bilan Scientifique Régional 2022, Ministère de la Culture)
La campagne de prospection-inventaire 2022 sur les territoires de Thorame-Basse et de Thorame-Haute avait pour objectif l’investigation des massifs et des alpages d’altitude (Mocci et Isoardi, 2018, 2019 et 2020). L’équipe était constituée d’archéologues du Centre Camille Jullian, d’étudiants d’Aix Marseille-Université, de Paris, de Strasbourg , et des membres des deux associations culturelles, Culture et Patrimoine (Thorame-Basse) et Patrimoine Culturel (Thorame-Haute) : CCJ /CNRS : Florence Mocci et Delphine Isoardi (responsables de l’opération), Lionel Roux et Loïc Damelet (photographes). SDA 04 : Thomas Castin. Etudiants en Licence et Master : Léon Bardavit, Marie-Claire Brelle, Clémence Koch, Perrine Nabet et Robin Veyron. Bénévoles : Petronille Boisson, André Bresson, Caroline Chaillan, Jean-Louis Clément, Paul Giraud, Grégoire Miguel, Gérard Milliat, Jeanne Suquet.
Cette opération a bénéficié du financement du SRA PACA, de l’Institut Arkaïa, du CCJ et d’associations de la commune de Thorame Haute (Les Amis de la Colle et Patrimoine Culturel) Les analyses de mobilier ont été effectuées par Stéphane Renault (LAMPEA) pour le lithique, et G. Guionova (LA3M) pour la céramique. Une étudiante en Master 1 à AMU, Perrine Nabet, travaille actuellement sur la provenance des matières premières lithiques du territoire de ces deux communes (dir. P. Magniez et F. Mocci).
Cette campagne s’est déroulée à l’automne, période à laquelle les troupeaux ne sont plus dans les alpages : la première, du 16 au 22 octobre, sur les hauts massifs de la Colle Saint Michel et de Peyresq (Thorame-Haute, 1600-2100 m) ; la seconde à la mi-novembre, sur les versants orientaux de la montagne de Cheval Blanc, a été écourtée au 3e jour en raison des cas de COVID dans l’équipe. 33 sites et indices de sites ont été inventoriés dont 29 se rattachent à la Préhistoire.

Sur la commune de Thorame-Haute
Sur les hauts massifs de la Colle Saint Michel, nous avons poursuivi l‘investigation de la Montagne de Champlatte sur lequel des gisements néolithiques et préhistoriques avaient déjà été identifiés lors des campagnes précédentes (alt. 1700-1850 m). À l’extrémité méridionale de ce massif (1680-1700 m), la découverte de nouveaux sites révèle, entres autres, une occupation au cours du Mésolithique (fragment d’armature) et du Néolithique moyen (fragment mésial de petite lame). Des indices de fréquentation au cours du Mésolithique avaient déjà été identifiées à plus de 2200 m d’altitude (Pisse en l’Air et Cheval Blanc).
À proximité du village de Peyresq et sur des plateaux de la Grau, l’occupation humaine au cours du Néolithique, de l’âge du Fer, de l’Antiquité et du Moyen-Âge central est attestée par du mobilier lithique et céramique (alt. 1600-1650 m). Un site se distingue tout particulièrement sur le versant d’un éperon, entaillé par la route actuelle, avec la présence, au sein d’une quinzaine de pièces lithiques, d’une flèche trapézoïdale du Néolithique ancien et d’un grattoir.
Autour du hameau de la Colle, une petite lame à crête avec retouches distales a été recueillie au sommet de Montruvel (1537 m). Quant à la montagne de la Charmette (alt. 1650-2000 m), en dehors des vestiges d’une cabane de pierres arasée, aucun mobilier a été découvert.
Ainsi, une occupation préhistorique d’altitude à l’extrémité orientale de la commune de Thorame-Haute Champlatte apparait réellement importante, longue dans la durée également, à l’image des massifs du Layon/ Petit Cordeil du côté de Thorame Basse (voir Mocci, Isoardi 2018, 2019, 2020).

Sur la commune de Thorame-Basse[Fig. 2].
À l’extrémité occidentale de la commune, sur les contreforts est de la Montagne de Cheval Blanc, les plateaux de Champ Gras ont livré des vestiges relevant de la fin de l’âge du Fer à l’Antiquité dont une belle table de mouture complète en grès du type à va et vient (d’autres fragments épars de grès sont disséminés sur ce versant) et une fibule de la fin de l’âge du Fer. L’existence d’un site ne fait pas de doute. Divers vestiges de structures en pierres, arasées, complètent l’inventaire, mais sont sans doute en lien avec la céramique vernissé moderne (on notera que cette zone, prospectée en 2018, n’avait alors strictement rien livré). En amont, la prospection difficile (neige, pluie, brouillard) sur la zone des Prés et de la Cabane de Paluet, vaste zone de pâture prometteuse (alt. 1870-2100 m), s’est révélée négative. Enfin, plus en amont, en allant vers le col du Talon, le site de Clauvas, découvert en 2018, a livré un complément d’objets lithiques.